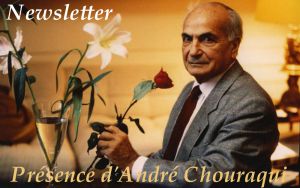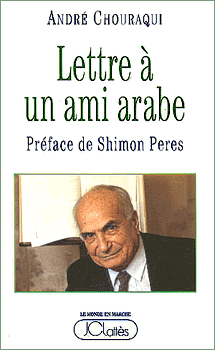 Convergences – pages 242 à 253
Convergences – pages 242 à 253
Lettre à un Ami arabe – Prix Sévigné, 5ème édition, Mame, 1969, réédition J. C. Lattès 1994
ISBN : 2709613808 – 317 pages.
Depuis cinquante ans, Juifs et Arabes se disputent en brandissant les titres qu’ils prétendent avoir à la possession de la Terre sainte. « Terre arabe» ; dites-vous, « Terre hébraïque » répondons-nous. Les Juifs se fondent sur la Bible et sur leurs aspirations millénaires à obtenir la réparation du tort que l’impérialisme romain leur avait causé au 1er siècle de notre ère. Aux racines, chez les Musulmans, la conscience aiguë qu’une terre qui a appartenu à l’Islam, à quelque moment que ce soit, reste à jamais terre d’Islam : « D’ailleurs, nous sommes les héritiers des Anglais et des Turcs ! » ; « S’il y a prescription en matière de souveraineté, vous êtes forclos comme vous prétendez que nous le sommes !… » Les thèses s’imbriquent et s’opposent si étroitement qu’on pourrait en discuter jusqu’à la fin du monde : les neuf cent quatre-vingt onze pages du dossier israélo-arabe publié par les Temps Modernes, en juin 1967, ne constituent, malgré son épaisseur, qu’une minuscule partie des millions de pages, des milliards de mots publiés en cette affaire. Trois cent soixante pages d’accusations arabes, répondent trois cent vingt pages de justification d’Israël. A chaque argument arabe, la pensée juive oppose dix réponses. A chacune d’entre elles, un esprit délié pourrait trouver cent répliques définitives, auxquelles pourraient s’opposer mille raisons, et ainsi de suite…
Pendant toutes ces années, j’ai suivi pas à pas l’évolution de ta pensée dans les articles que tu publiais dans les revues et les journaux arabes, dans ce que la presse rapportait de tes discours.
Je connaissais la clarté de ton intelligence, la vigueur de ton style, le courage qui te portait toujours au-delà de ce que la prudence, et parfois la raison, pouvaient conseiller. Je savais aussi les liens qui t’unissaient à Israël : ta famille venait d’un de ces villages des monts de Judée où, comme en Galilée, la population n’a jamais été renouvelée. Tu aimais à te proclamer, et avec toutes les évidences de ton côté, un vrai descendant du peuple de la Bible. Comme beaucoup de Palestiniens, tu parlais l’hébreu avec un accent oriental qui me ravissait : tu réhabilitais notre langue déformée par un grand nombre d’Israéliens originaires d’Europe qui renoncent à prononcer les gutturales, comme elles doivent l’être. Tu étais nourri de culture hébraïque, imprégné des idéaux du libéralisme français, ivre aussi de sentir au fond de ton être une puissance qui aspirait à se manifester par la pensée, par l’écrit, par la parole, par l’action enfin. Sans parler des liens affectifs qui t’unissaient à tant de Juifs. Je recherchais dans ton œuvre une trace de ce qui était pour moi ton vrai visage : il ne restait rien de cette partie de toi qui t’unissait si profondément à moi, à Israël. Tu avais effacé tout le passé judéo-arabe, tu voulais ignorer les réalisations du sionisme israélien, il n’existait pour toi aucune possibilité d’une nouvelle symbiose israélo-arabe mise au service des peuples du Moyen-Orient et de la paix mondiale. Tu étais épris d’idéaux démocratiques : la dictature nassérienne te paraissait cadrer avec la conception nouvelle que tu te faisais du socialisme. Enfin, je voyais naître sous ta plume le Monstre que les propagandes arabes s’efforçaient d’interposer entre nous, un Juif hideux, synthèse repoussante des caricatures proposées par la haine antisémite du Moyen Age et du parti national-socialiste allemand. A te lire, je sentais mon nez devenir crochu, mes yeux s’exorbiter, mes oreilles se décoller, mes doigts se pourvoir de griffes, mes pieds devenir semblables à ceux du diable. Je me sentais prêt à boire le sang des enfants chrétiens… Rappelle-toi ce dessin qui représente un Juif horrible, au nez aussi crochu que possible, le cou pris dans l’hexagone central du sceau de Salomon, tandis qu’un Arabe chevaleresque et justicier tire très fort la pointe des deux triangles entrelacés. La haine a de ces inventions… Les thèmes de la propagande arabe concernant Israël sont peu nombreux mais constamment ressassés et avec tant de conviction qu’ils finissent par troubler même la bonne conscience de l’honnête homme. Par violence, Sarah obtint d’Abraham qu’il chasse Agar, la servante, et son fils, Ismaël dans les déserts dont il devint le fils. Par ruse, Jacob usurpa d’Isaac la bénédiction qui revenait à Ésaü. Les propagandistes arabes avec fureur disent au monde : « L’histoire biblique continue : par violence et par ruse, les juifs nous ont dépossédés de nos terres, de nos biens, de notre honneur, de notre liberté. Nous n’aurons de cesse que lorsque nous nous serons vengés. » Et de fait la blessure faite à l’âme arabe est profonde. La critique arabe dénie toute ombre de valeur aux thèses sionistes : elle s’évertue avec beaucoup d’ingéniosité, et depuis peu de temps, avec un certain succès, à donner du Juif une image peut-être ressemblante mais dans laquelle nous avons du mal à nous reconnaître. Faut-il revenir sur les thèmes de cette propagande ? Nous sommes des impérialistes, des colonialistes, des voleurs de terre, des usurpateurs qui ont trompé non seulement les nations arabes mais les Nations unies. Nous sommes des étrangers sur notre propre terre à laquelle ni la Bible, ni l’histoire, ni les décisions des Nations unies, n’ont jamais donné aucun droit, des agresseurs assoiffés de sang, des brigands que le Conseil de sécurité n’a jamais cessé de condamner, des racistes qui vouent des minorités au désespoir et à la honte, au déshonneur et à la misère. Nous sommes les metteurs en scène et les profiteurs de la tragédie des réfugiés.
Ces griefs anciens sont considérablement amplifiés depuis la guerre de juin 1967, dont les résultats confirment aux yeux de nos censeurs toutes les accusations dont ils nous abreuvent depuis vingt ans. Après avoir fait à peu près tout ce qu’il fallait pour nous entraîner dans ce beau gâchis, ils se tournent à nouveau vers le monde en criant : « Nous vous l’avions bien dit ! » Un pamphlet, publié par l’ambassade d’Irak à Paris au lendemain de la guerre des Six Jours, résume bien ce point de vue : Israël ne se compose que d’un groupe d’hommes de nationalités diverses venues des quatre coins du monde pour s’emparer des terres et des biens de tout un peuple, le chasser de son foyer, poussés par un mobile fondé exclusivement sur le racisme et faisant table rase du principe du règne de la majorité et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Cette campagne a un but très évident : effrayer le monde : « Le sionisme est parvenu en utilisant toutes sortes de pressions à dominer la plupart des moyens d’information pour dénaturer à son profit des faits incontestables, ayant pour objectif d’étendre d’une manière définitive sa domination sur le monde. » Les écrivains, arabes ou pro-arabes qui ont versé leur témoignage au dossier israélo-arabe des Temps modernes déploient leur science et leur talent pour analyser ces grands thèmes, les approfondir, les étayer d’arguments fondés en théologie, en en droit, en fait, au regard de la morale, de la justice, de l’humanité. Leur plaidoyer prend même la défense des intérêts du judaïsme et des Juifs qui devraient comprendre d’eux-mêmes l’étendue de leurs torts, demander pardon, plier bagage, et laisser enfin la place aux Arabes, avant que ceux-ci ne les exterminent. C’est ce que me disait une bonne Chrétienne arabe de ce pays, le 3 juin 1967 !… C’est ce qu’écrivaient les meilleurs parmi les penseurs, les philosophes, les juristes, les sociologues arabes ou pro-arabes tel Maxime Rodinson pour qui Israël n’est qu’un « fait colonial ». Mounthir Anabtawi dépasse cette prudence en accusant Israël d’être un « mouvement colonialiste, chauvin et militariste », représentant un danger permanent pour la liberté des peuples et la paix mondiale. Abdul Wahhab Kayyali, que tu connais bien pour son action au Centre des Recherches de l’Organisation de Libération de la Palestine, insiste surtout sur « le caractère expansionniste agressif de l’État d’Israël ».
Le problème des réfugiés constitue la source des arguments les plus difficilement réfutables de la thèse arabe, fortifiée encore par la grande pitié des victimes de la dernière guerre. Loufti El Kholi dénonce en Israël un ghetto et un bastion de l’impérialisme. Pour renforcer cette thèse, on a recours à un Marocain généralement mieux inspiré, Abdallah Laroui qui nie le caractère socialiste – au sens scientifique du terme – de l’État d’Israël. Si l’Égypte de Nasser est à ses yeux l’exemple parfait du socialisme appliqué, je me crois prêt, ma foi, à souscrire à son jugement. Un autre Marocain, Tahar Benziane, conclut une longue analyse d’une manière drastique : « Si les Juifs, au contraire, refusent de s’intégrer, la Palestine n’aura d’autre solution que de rejeter ce corps étranger et agressif qui ne veut pas obéir aux lois élémentaires de l’humanité. » Par bonheur, il m’excepte de l’anathème : « Les Juifs originaires de Palestine, eux, en tout état de cause, sont sur leur propre terre qui est celle de leurs ancêtres palestiniens de confession juive. » Si j’avais la moindre envie de polémiquer, je demanderais à Benziane ce qu’il fait des quatre ou cinq cent mille Juifs d’Afrique du Nord qui, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, étaient, en tout état de cause sur leur propre terre qui est celle de leurs ancêtres maghrébins de confession juive et, qui néanmoins, durent partir, dépossédés de tous leurs biens.
Un admirable cri du cœur d’un Égyptien, Ali Alsamman, que tu as dû rencontrer à Paris où il est le correspondant de dant de AI Abram clôture l’exposé des thèses arabes réunies par les Temps modernes : « Je hais ce sionisme qui sépare l’Arabe du Juif. » Cri d’amour et de haine à la fois, peut-on mieux avouer l’impasse où aboutit l’actuel point de vue arabe sur Israël ?
Il y a le sang versé, il y a les souffrances inimaginables des survivants : les veuves, les orphelins, les parents des soldats tués au front. Il y a aussi les indicibles malheurs des réfugiés.
As-tu lu cet affreux récit publié par le Monde où l’un d’eux raconte comment, mû par le désespoir, il a noyé dans le Jourdain sa fille, un bébé ?
Il y a les dangers de guerre mondiale que le conflit proche-oriental porte en lui. Il y a la flambée des milliards de dollars jetés dans les caisses étrangères des marchands de canon et de… Mirages. Il y a la perte d’indépendance que ce conflit absurde provoque en nous jetant dans la dépendance des grandes puissances qui se servent des Juifs et des Arabes pour leur propre politique à l’échelle de la planète : dans cette perspective, notre conflit fait de nous des pions sur un échiquier.
Mais plus gravement encore, peut-être, à mes yeux, vingt ans de guerre ont fait de nous, qui vivions comme des frères, des étrangers. Je recherche, dans ton visage marqué par la tragédie de ta guerre et de ta défaite, tes expressions d’enfant et d’adolescent, celui que j’ai connu et aimé à Jérusalem, à Paris. Où est la fraîcheur de ton rire, le pli rieur de tes yeux, la confiance détendue de notre étroite amitié : nous n’avions pas de secret l’un pour l’autre, David et Jonathan ressuscités sur les collines de Judée au grand vent de nos promenades ? Je te vois ravagé, intérieurement miné par ta déception personnelle liée au grand drame, aux souffrances inouïes de ton peuple. Au bout de vingt ans, nous sommes devenus des étrangers l’un pour l’autre et pourtant notre ascendance, nos études, les projets que nous faisions, nous préparaient à un même avenir.
Je suis maintenant attelé aux affaires d’un État qui n’est pas tien et ta défaite explique ma survie. J’avais grandi en milieu arabe ; mon fils, à Jérusalem, n’avait jamais vu d’Arabe avant notre rencontre, et la seule expression de l’arabisme qui soit jamais parvenue à ses oreilles était l’explosion des balles que la Légion arabe tirait parfois sur nos fenêtres.
En Israël, la minorité arabe, victime du conflit qui nous déchirait, vivait repliée sur elle-même et n’avait à peu près aucun contact avec les Juifs. En pays arabes, l’idéal était de faire comme si Israël n’existait pas : on supprimait son nom sur les cartes, sur les placards publicitaires des journaux et même, dans certaines églises du Liban, des Psaumes que les fidèles récitaient. Les surfaces de contact entre Arabes et Juifs qui, voici vingt ans, couvraient toute l’étendue du monde arabe avaient subi le sort de la peau de chagrin ; les ponts sautaient partout : nous ne touchions qu’aux points les plus douloureux et les plus critiques.
En pays arabes, les communautés juives avaient été liquidées sans phrase, en créant des centaines de milliers de réfugiés dont personne ne parle et qu’aucun organisme international n’a songé à prendre en charge : des Juifs tout juste bons à être abandonnés à la charge de la juiverie. Dans toute l’étendue des terres d’Islam, à chaque secousse provoquée par le conflit israélo-arabe, les Juifs abandonnaient les pays dans lesquels ils étaient établis depuis des millénaires, et où ils étaient arrivés souvent avant la conquête musulmane. En Asie, en Afrique du Nord, le triomphe du nationalisme s’est partout accompagné de la liquidation totale ou partielle des communautés juives. La totalité des Juifs du Yémen, quatre-vingt-dix-huit pour cent des Juifs irakiens, d’Aden, tous les Juifs de Jordanie, quatre-vingt-quinze pour cent des Juifs syriens, quatre-vingt-seize pour cent des Juifs égyptiens, quatre-vingt-quinze pour cent Juifs libyens, la plupart des Juifs afghans, kurdes, indiens, une importante partie des Juifs iraniens, turcs, libanais, quatre-vingt-dix pour cent des Juifs tunisiens, quatre-vingt-dix-neuf pour cent des Juifs algériens, près de quatre-vingt-dix pour cent des Juifs marocains ont quitté leur pays natal depuis la création de l’État d’Israël. Leur exode souvent a été dramatique, dans la nuit de la clandestinité où la police les reléguait. Le plus souvent, ils partaient en laissant tous leurs biens, aussitôt confisqués par les gouvernements arabes. Des sommes considérables, représentant des générations de travail et d’économie ont été ainsi perdues pour ces réfugiés dont la plupart refirent leur vie en Israël en partant de zéro. Je préfère passer sur la manière dont les Juifs habitant les pays musulmans ont appris à connaître les bienfaits de la police syrienne, égyptienne ou marocaine ; oui, passons…
La guerre de 1948, les accords d’armistice avaient transformé l’État d’Israël en une forteresse fermée hermétiquement du côté des Arabes. Pendant vingt ans, l’abîme s’était creusé si profondément entre Arabes et Juifs qu’il semblait que nous habitions non pas les parties différentes d’un même pays, mais deux planètes. Les contacts étaient devenus à peu près impossibles ou inefficaces : en Israël, une frontière sanglante nous séparait. Ailleurs, en Afrique du Nord, en Libye, en Égypte, au Liban, en Syrie, en Irak, en Jordanie, au Yémen, les Juifs qui survivaient au grand exode n’avaient plus la possibilité d’un échange libre.
Le conflit empoisonnait les relations entre Arabes et Juifs partout où ils cohabitaient et ruinait toute chance de dialogue. J’eus souvent pendant cette période l’occasion de parler avec des Arabes. En Israël, leur situation portait à faux : quels que fussent leurs opinions et l’avantage ou le désavantage qu’ils retiraient de notre présence, ils ne pouvaient s’exprimer sans complexe. La frontière qui séparait les pays arabes d’Israël passait à vrai dire par leur cœur, les déchirait, et souvent les torturait. Nous le sentions si bien que nous avions fini par n’en plus parler. Nos problèmes quotidiens étaient suffisants pour nous occuper les uns et les autres. Nous étions voués à la construction du pays. Pendant vingt ans, malgré les incitations venues de l’étranger, la coexistence fut paisible encore que dépourvue de véritables échanges. Chacun couvait sa peine : l’Arabe, sa guerre, le Juif, sa quête du repos ; comme dans les vieux ménages aux disputes sclérosées, on vivait ensemble sans se parler.
La solitude arabe, au fond, était pire que la nôtre, à bien des égards. En Israël, ils étaient les citoyens d’un État, dont, pour la plupart, ils n’avaient pas voulu la naissance, et qui était contraint de prendre à leur encontre des mesures de sécurité difficilement supportées. L’État d’Israël devait d’abord penser à sa survie : quelle qu’ait pu être sa volonté en ce qui concerne l’intégration des Arabes, il était soumis à des impératifs politiques qui aboutissaient à des mesures, ressenties de la part de la population arabe, comme injurieuses et discriminatoires. L’effort fait par le Gouvernement d’Israël dans le domaine de l’habitant, de l’instruction, de l’hygiène, ne changeait rien au drame vécu par les Arabes d’Israël. Ils pouvaient jouir du plus haut niveau de vie connu dans toute l’étendue du monde arabe, ils pouvaient avoir atteint le plus haut degré de scolarisation pour leur jeunesse, ils pouvaient même voir combien vaine et folle était la querelle de l’Égypte contre Israël : cela ne changeait rien à leur déchirement, intérieur, bruyamment entretenu par les radios du Caire, d’Amman, de Damas, de Bagdad. Je comprenais bien leur drame aggravé par les conséquences du partage, la séparation des familles, le départ des réfugiés, la confiscation ou l’expropriation de certaines terres. L’hébraïsation de l’État rendait plus difficile leur intégration : d’ailleurs le principe d’égalité ne pouvait plus jouer dans l’économie de la guerre qui nous déchirait.
Aussi, certains Arabes d’Israël avaient-ils beau jeu de se plaindre de leur sort dans un rapport adressé en 1964 au secrétaire général des Nations unies. Ils se déclaraient les victimes d’une politique d’oppression de discrimination raciale, et en butte à la persécution du gouvernement israélien. Pour eux, celui-ci poursuivait une politique de haine contre les Arabes, et stimulait des sentiments hostiles parmi le peuple juif, les écoliers, les étudiants. Davantage que dans le domaine des sentiments et de la propagande, les Arabes dénonçaient les violations réelles de leurs droits : ils se référaient aux conséquences e la guerre de 1948, à certaines expropriations de terres (Loi sur la propriété des personnes absentes de 1950, critiquée dans son principe même), de certaines destructions de villages, Ikret par exemple, ou d’expropriations légales, mais faites à des prix peu satisfaisants. Toute la législation israélienne promulguée pour faciliter l’hébraïsation de l’État, la judaïsation de la Galilée, était âprement dénoncée comme contraire à l’ordre et aux engagements internationaux de l’État. Le problème posé par les biens des fondations religieuses (Waqfs), pris en charge par l’administration israélienne, en l’absence de leurs bénéficiaires, était soulevé : les mesures prises par les Juifs étaient dénoncées avec passion.
L’autorité militaire, chargée de sauvegarder l’ordre et la sécurité dans les parties arabes du territoire, était dénoncée comme l’œuvre du diable ; d’après ce rapport, elle ne faisait que « propager la dissension, la peur, la terreur » ; elle ne servait qu’à aggraver la politique de discrimination menée contre les Arabes d’Israël dans tous les aspects de la vie publique et privée.
Ce rapport s’inspirait des revendications du groupe « Al Ard » qui souhaitait pour tous les Arabes d’Israël la fin de la discrimination et de l’oppression ; l’adoption du plan de partage de la Palestine de 1947, qui à l’époque avait été accepté par les Juifs et refusé par les Arabes ; la reconnaissance du nationalisme arabe, socialiste et neutraliste. Al Ard était persuadé, surtout après qu’il eut été interdit par décision judiciaire, que le Gouvernement d’Israël avait pour but de « créer un état de peur, de désespoir, de soumission[1] « . Les lois d’urgence : toute cette écume que les vagues de la guerre ont fait déferler sur notre pays étaient dénoncées avec violence.
Bien entendu, le point de vue d’Al Ard était partagé par un grand nombre d’Arabes. Pour eux, les promesses du Caire et des autres capitales arabes étaient réelles. Leur situation de minoritaires – même privilégiés par rapport à la situation de leurs frères des autres pays arabes – sur le plan économique notamment, était transitoire. Viendrait le jour de la vengeance et du salut. 1948, 1956 avaient déçu les espérances du nationalisme arabe, mais si deux batailles avaient été perdues, la guerre continuait. Ainsi quand la crise de mai 1967 commença, les nationalistes arabes, d’inspiration nassérienne, crurent arrivé le jour de gloire. « Pourquoi ne quittez-vous pas le pays avant que les Égyptiens ne vous exterminent, me dit l’un d’eux ; vous auriez du moins la vie sauve. » D’autres cherchaient à repérer les maisons qu’ils occuperaient après leur victoire. Certains étudiants arabes conseillaient à leurs camarades israéliens d’acheter des maillots de bain qui, après tout, pourraient ne pas être inutiles lorsque les Égyptiens, les Syriens et les Jordaniens les auraient rejetés à la mer.
Rancœur et esprit de revanche qui n’étaient pas partagés par une grande partie de la population arabe, soucieuse avant tout de paix, ni par les Druzes, profondément intégrés en Israël et conscients d’y jouir d’une pleine égalité des droits et des devoirs.
Depuis le 15 mai 1967 les menaces de Nasser n’étaient plus verbales, mais s’accompagnaient de déploiement de forces. Les armées de Nasser s’apprêtaient à fondre sur les nôtres, pour nous exterminer. A nouveau la chape de plomb, l’esseulement abyssal. Les radios arabes nous apportaient les hurlements déments des dictateurs arabes ou de leurs porte-parole. C’était en arabe le même déploiement de menaces mortelles que celles qui nous poursuivaient en Europe hitlérienne. Il ne s’agissait pas de nous présenter tels que nous sommes, mais tels que nous devrions être pour justifier les grands massacres que l’on nous promettait au Caire, à Damas, à Amman.
« Égorge, égorge, égorge et sois sans pitié,
Égorge, égorge, égorge, et lance leur tête
Dans le désert,
Égorge, égorge, égorge
Tout ce que tu voudras,
Égorge tous les sionistes et tu vaincras »
chantait, au Caire et à Damas, Oum Kalsoum. Pour que nous soyons égorgeables, sans trop de remords, il fallait que dans l’esprit de nos égorgeurs éventuels nous cessions d’avoir figure d’hommes. Ainsi les colonialistes et les racistes avaient-ils mis au point une technique de propagande très efficace destinée à déshumaniser l’ennemi – celui qu’il faut continuer à exploiter ou qu’il faut assassiner -, au point de le réduire à l’état d’objet, non de personne. Le meurtre alors n’est plus gêné par la mauvaise conscience. Ces recettes avaient fait leurs preuves dans les différents pays d’Asie et d’Afrique où des Occidentaux s’opposaient à des peuples colonisés. Mais, en l’espèce, elles furent utilisées par les dictateurs arabes contre Israël.
Pour nous, le blocus du détroit de Tiran décrété par Nasser le 22 mai, les incessantes attaques de notre territoire par les Syriens, le dur bombardement de Jérusalem par les Jordaniens au matin du 5 juin 1967 constituaient des manœuvres agressives caractérisées. Or les chefs arabes continuent de parler de l’agression israélienne. A vrai dire, ils ont raison à leur manière puisqu’ils dénient notre droit de vivre. Le seul fait de notre existence, en tant qu’État, introduit un trouble dans l’ordre du monde, constitue une agression permanente contre « leur » paix. Même si nous passions notre temps à chanter, jour et nuit, des psaumes et des cantiques, nous n’en continuerions pas moins notre diabolique agression qui ne pourrait prendre fin qu’avec le terme de notre existence.
Nous étions donc persuadés qu’un triomphe arabe réaliserait les prophéties et les ambitions de Choukeïri : l’extermination des survivants des massacres hitlériens. Au terme de la guerre des Six jours, les hommes menacés que nous étions se retrouvaient soudain en position de force : nous étions à la tête d’un Empire plus vaste que nos ancêtres ne l’avaient jamais rêvé ; nous étions des occupants et, par la force des choses, nous devenions aussi des policiers. Étrange destin que celui qui vouait les exterminateurs au rôle de victimes et les candidats au martyre, aux fonctions de bourreau. Soulagement de la victoire : il s’est exprimé chez nous avec beaucoup de pondération. Nous savions que nous n’avions pas fini de gravir notre calvaire. C’était plutôt pour nous le franchissement d’une étape et non le havre souhaité. Israël était devenu l’occupant malgré lui, vainqueur grâce à l’obstination aveugle de ses ennemis. Soudain le problème se compliquait redoutablement ; jadis, la situation était pour nous relativement simple ; il s’agissait d’être ou de ne pas être : les choses étaient claires. Nous remplissions notre rôle vis-à-vis de nous-mêmes et nous correspondions à l’idée que le monde depuis quatre mille ans se faisait de nous : des sursitaires. Au suspense de notre destin, il était possible de prévoir et d’attendre une fin tragique, la continuation de l’œuvre de mort. Après tout, tant qu’il y avait un Juif vivant, il y aurait suffisamment de place pour lui dans les grands cimetières de l’histoire ou la fumée des crématoires.
La victoire pipait tous les dés, faussait tous les calculs : le petit Juif du ghetto trichait aux yeux du monde en devenant d’indésirable vainqueur d’une guerre qui constituait sans doute l’insurpassable chef-d’œuvre de la stratégie conventionnelle. Le monde entier pouvait s’attendre avec nous à une fin convenable du trouble qu’Israël n’a cessé d’apporter dans l’histoire depuis la folle aventure d’Abraham : l’effondrement militaire de l’armée juive, les hordes arabes se ruant sur nos femmes, nos enfants, nos foyers, pour parachever splendidement l’œuvre qu’Hitler n’avait pas su mener à son terme logique.
Aux yeux du monde, la victime est devenue bourreau et nous sommes à la tête d’un Empire qui va des pentes de l’Hermon au canal de Suez, du golfe d’Akaba aux rives du Jourdain. Sûrs de nous-mêmes et dominateurs, par cela même faussaires, trublions renversant l’échelle des valeurs. Nietzsche lui-même ne reconnaîtrait plus ses Juifs : d’esclaves, les voici soudain promus au rang de seigneurs. Mais cela même nous a surpris et blessés : nous étions moins en quête de domination que de liberté et de vie. L’image nouvelle de nous-mêmes qui étonnait le monde ne cesse de nous troubler : les uns, d’ivresse, les autres, de nostalgie. La situation nouvelle provoque un universel scandale, le bouleversement de toutes les valeurs, des stéréotypes les plus invétérés.
Les plus faibles, sans doute, se réfugient derrière cette victoire pour rêver une solution qui délivrerait à jamais Israël des ses ennemis : garder tous les territoires conquis, se situer en position de force jusqu’à l’effondrement total de la résistance arabe et sa reddition. Les autres rêvent de paix, de délivrance messianique : ils ont physiquement besoin de voir le lion brouter en paix aux côtés de l’agneau et gémissent après les visions de chars convertis en charrues. Débats tragiques et dérisoires, débats de Juifs.
A l’intérieur des frontières, nous, Israéliens, nous nous déchirons dans nos contradictions et nos luttes intérieures, stérilement, comme nos ancêtres épilaient leur barbe aux arguties du Talmud. Notre déchirement aboutit à un débat académique tandis qu’en face de nous, ceux qui devraient être nos interlocuteurs sont bloqués par la peur et par la honte de leur défaite.
A mesure que la tragédie s’approfondit, que les attentas font davantage de victimes et que la répression sème la peur, les extrémistes se renforcent : Nasser, le grand vaincu de juin 1967, continue de prêcher l’extermination d’Israël. Quelques propagandistes arabes, plus nuancés, essaient de distinguer entre le génocide et qu’ils appellent le politicide : il ne s’agissait plus de tuer les Juifs d’Israël mais leur État ; comme si ceux-ci pouvaient survivre à celui-là. En face de ces menaces qui nous rappellent certaines voix arabes de 1967 et celles qui, en allemand, annonçaient, aux années 40, de définitifs massacres, nous entendons s’élever quelques voix juives tremblantes d’angoisse qui exigent de l’État d’Israël une défense radicale de nos vies par une élimination violente des dangers du terrorisme. D’un côté, on souhaite que la Palestine soit tout entière arabe, tandis que de l’autre on n’attribue de chances de survie à Israël que dans le cadre d’un État juif allant des flancs de l’Hermon aux rives du Jourdain et du canal de Suez.
[1] Le conflit israélo-arabe, Les Temps Modernes, Paris 1967, p. 792