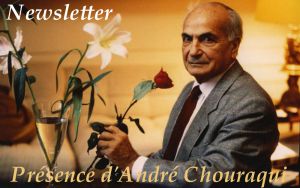André Chouraqui, Mon testament – le feu de l’Alliance, Bayard Press, 2001.
pages.13-21 ; Introduction
*****
Introduction
 Tout homme est compris dans l’enfant qu’il était jadis. Natif des sables de l’Algérie coloniale, j’ai grandi pour donner naissance au vieil homme que je suis aujourd’hui. Ain-Temouchent m’a nourri en son sein, m’a imprégné de tout son être. Là, j’appris à voir et à marcher, à regarder et à aimer, là mon être prit son envol pour me faire poursuivre les migrations de ma vie.
Tout homme est compris dans l’enfant qu’il était jadis. Natif des sables de l’Algérie coloniale, j’ai grandi pour donner naissance au vieil homme que je suis aujourd’hui. Ain-Temouchent m’a nourri en son sein, m’a imprégné de tout son être. Là, j’appris à voir et à marcher, à regarder et à aimer, là mon être prit son envol pour me faire poursuivre les migrations de ma vie.
La petite communauté juive d’Ain-Temouchent était un surgeon d’une communauté beaucoup plus ancienne, la communauté juive de Tlemcen. Mes quatre grands-parents sont nés à Tlemcen. Mes ancêtres, chassés de Judée par les Romains, ont erré à travers la Méditerranée pour s’installer en Andalousie pendant plusieurs siècles. Ils en partirent en 1392 pour vivre à Tlemcen, un royaume indépendant entre l’Algérie et le Maroc.
Très tôt la petite ville d’Ain-Temouchent me révéla les beautés et les iniquités qui font de la vie sur terre un constant mariage des paradoxes auquel nous adhérons depuis notre premier cri, pour le meilleur ou pour le pire. A travers la douceur matricielle du gynécée de ma mère et de mes sœurs m’étaient révélés les charmes d’une nature clémente et aimante. L’âpreté prévalait dans les relations entre les hommes. J’y découvrais les ferments de la discorde qu’il me faudrait combattre pour laisser en la vie rayonner cette lumière dont elle est porteuse.
Microcosme du monde ouvert à mes bras, on aurait dit qu’Ain-Temouchent avait convié en ses terres les divisions de l’humanité comme pour mieux me les faire connaître. Les plaies ouvertes de la fraternité blessée des hommes s’étalaient sous mes yeux et je m’interrogeais sur le remède adéquat.
La difficile cohabitation des colons et des colonisés, des Français et des Arabes, des Arabes et des Juifs, des autochtones et des immigrés, des juifs, des musulmans et des chrétiens, dans toutes leurs spécificités, me laissait prévoir les vertigineuses divisions dans lesquelles l’Algérie française allait disparaître. À Ain-Temouchent, dont le nom signifie en berbère « la source des chacals », je voyais la colonie française se livrer à l’ivresse de ses conflits, à ces drogues qui la hantaient. Il n’était pas une semaine sans une altercation entre groupes opposés.
Sans cesse, la division s’ajoutait à la division. Alors les prêches du curé faisaient résonner à mes oreilles la douloureuse accusation d’assassin du Christ. Ma judaïté était le crime que mes épaules d’enfant devaient porter. Sans même savoir qui pouvait être le Christ, moi le jeune Natân André Chouraqui, je craignais les regards des fidèles de l’Église, si bien que malgré ma claudication, je n’hésitais pas à faire un long détour pour me rendre chez ma tante, à l’autre bout de la ville, et ne pas me risquer à passer devant ce clocher édifié pour illustrer mon crime. Mais au loin, j’entendais les cris contre les juifs au gré des sermons assenés à ses ouailles par le pasteur des Trois Marabouts.
La décision de la IIIe République de faire des juifs des citoyens français, en vertu du décret Crémieux du 24 octobre 1870, ouvrait pour notre communauté des horizons incertains. Mes ancêtres avaient vécu en fraternité avec les musulmans, réalisant leur osmose sémitique au plus profond de leurs êtres. Dorénavant, les décrets de l’État français nous coupaient de nos racines. Mes grands-parents expliquaient à leurs voisins leur désarroi, les assurant de leur fidélité, et les plus compréhensifs répondaient : « Ne vous inquiétez pas, ça passera. » Mais il n’en fut rien et la société algérienne se scinda radicalement en colonisateurs français et colonisés musulmans, laissant les juifs dans une situation intermédiaire marginalisée. Cette situation ne pouvait que conforter l’extrémisme de certains Arabes à notre égard : yahoud el kelb, le « chien de juif », était condamné à disparaître dans les tourments de l’Algérie nouvelle.
Et l’on ne devient pas français si facilement ! Au lendemain du décret Crémieux, les juifs représentèrent un enjeu politique qui mit fin à leur tranquillité. L’agitation antijuive d’un Drumont, relayée en Algérie par l’action de Max Régis, laissait dans les cœurs une blessure que même des amitiés chrétiennes n’arrivaient pas à panser. Max Régis avait réussi à déchaîner des émeutes dirigées contre les juifs à Alger, Mascara, Mostaganem, Affreville, Sétif, Oran. Des synagogues avaient été profanées, des magasins pillés, des hommes blessés ou tués. Ces morts ternissaient la joie de notre adoption au sein de notre culture nouvelle, celle de la République française.
La gravité de nos vies était faite de notre solitude. J’ai passionnément aimé mon Algérie natale, Ain-Temouchent, son ciel de feu, ses vignobles, sa terre rouge, épaisse, fertile, ses cactus et son azur, ses oliviers, la mer toute proche, ma Méditerranée, infiniment présente, nourricière. Des heures entières je nageais dans ses eaux ou m’offrais sur ses plages aux brûlures de son soleil. Ses rives, ses genêts, la variété de sa flore et de sa faune, ses aurores et ses crépuscules n’ont cessé d’inspirer et d’exalter mon adolescence. Je ne me suis jamais lassé de ses paysages comme de ses traditions et de sa culture, celle des peuples qui l’occupèrent dont je lisais l’histoire sur les pierres de nos cimetières.
Je haïssais le racisme de ceux qui ne surent jamais voir dans les Algériens que des « bicots », aveugles devant la noblesse de leurs traditions vivantes. La grande misère des masses n’effaça jamais une profondeur spirituelle que je ne me lassai pas de découvrir et d’admirer sur mes routes, dans mes conversations jamais décevantes avec ces hommes forts et humbles, vrais et douloureux témoins des réalités transcendantes de l’homme. Oui, davantage que de la haine, j’éprouvais du mépris devant le matérialisme d’une certaine bourgeoisie algérienne. Mon Algérie à moi était différente de celle des Arabes et plus encore de celle des colons. Elle se situait dans un au-delà sans âge, sans rapport profond avec le milieu où elle était plaquée, dans l’ignorance à peu près complète de ses racines.
Dès mon plus jeune âge, lorsque mes yeux commencèrent à s’ouvrir sur le monde, je voyais bien que nous étions d’ ailleurs. D’un autre lieu : cette Jérusalem qui occupait nos pensées se trouvait fort loin d’Ain-Temouchent, puisque nous tournions nos regards vers le Levant en disant nos prières. Aussi loin que nous regardions, nous ne réussissions pas à l’apercevoir. Car cet ailleurs d’où nous venions était encore plus éloigné de nous dans le temps que dans l’espace. En ce premier quart du Xxe siècle, nous étions en fait, grâce à la Bible, les contemporains d’un monde aboli qui peuplait ainsi nos jours et nos nuits, imprégnait nos pensées, formait notre sensibilité beaucoup plus sûrement que le milieu où nous vivions et dont notre condition de juifs nous séparait.
Être juif, géographiquement et chronologiquement, c’était être d’ailleurs. Notre lieu n’était ni un pays ni un temps déterminé, mais plus gravement un Livre que nous étions à peu près les seuls au monde à savoir lire dans la langue où il fut écrit : l’hébreu et, pour quelques-uns de ses chapitres, l’araméen. Cette langue, aucun de nos voisins arabes ou chrétiens n’était en mesure d’en comprendre un mot. Nous, c’était avec elle que nous apprenions à lire.
Être juif, pour moi, c’était l’image de mon père. Fidèlement, il se rendait à la synagogue pour les trois offices quotidiens. Il récitait les Psaumes que nos ancêtres avaient toujours emportés dans leurs exils et m’invitait à en partager le mystère. Bien peu d’entre nous comprenaient la signification profonde de ces textes qui, cependant, opéraient sur nous tous la même magie, celle du transport de nos êtres*dans l’abandon à la parole d’Elohîms. Dans Son verbe, nous retrouvions notre identité.
Chaque homme est tout entier désigné dans le nom qu’il porte, et parfois le façonne dans la magie du Verbe qui nous fonde. Je porte en mon nom et au tréfonds de ma personne trois langues et trois cultures : l’hébraïque, la grecque et l’arabe : Natân André Chouraqui. Natân — prononcé Natane — est tiré de la Bible où il apparaît en quarante-deux occurrences. Très répandu au sein des communautés juives et chrétiennes sous la forme de Nathan, Nethanael, Natanyah, il plaît surtout de par son sens : « Dieu a donné ». Ce qui m’interpelle le plus, c’est qu’il se lise indifféremment de droite à gauche et de gauche à droite : Natân, ‘IN’, demeure invariablement celui « qui donne » et « qui est donné ».
André, mon prénom destiné à l’usage social en France, signifie « homme », en grec, andros. Ce que Dieu donne, c’est un homme. Et un « homme venu de l’Orient ». Chouraqui dérive de la racine arabe qui désigne le Levant, al-Charq. al-Charqi’in sont les Orientaux. En latin, il est devenu Sarracinus, les Sarrasins, mot dérivé de la même racine qui désigne en français l’Orient et les Orientaux : Sherkiyim.
Sur cette terre, au regard du ciel qui sait tout, Elohîms avait fait à mes parents, dont j’étais le neuvième enfant, le don d’un homme venu de l’Orient né pendant la Grande Guerre, en Algérie française, au carrefour de trois cultures, l’hébraïque de mes plus profondes racines, la gréco-latine de ma formation française, l’arabe, enfin, du pays de ma naissance, langue que mes ancêtres parlaient probablement depuis plus d’un millénaire.
L’école française, dès mes premières leçons, m’avait convaincu que mes « ancêtres les Gaulois étaient grands, braves, forts et querelleurs et que leurs prêtres s’appelaient les druides Nous fûmes ainsi radicalement expatriés de nos racines. Du rabbin de ma synagogue je passais au druide d’une forêt inconnue sans bien sûr remettre ce dogme en question : j’étais à l’école pour apprendre. Étrangement, mes parents ne semblaient pas s’inquiéter de ces révolutions : la France m’offrait la possibilité de « devenir un homme ». Cela devait s’avérer exact car sans les outils de réflexion qu’elle me permit d’acquérir, je n’aurais certes pas accompli le trajet de vie qui fut le mien.
Le rationalisme des philosophes des Lumières, enseigné par les meilleurs professeurs, ceux que le « tiers colonial » dédommageait de vivre sous l’azur algérien, devint ma nouvelle religion. J’étais prêt à envoyer mes maîtres d’arabe Abderahmân, Donnat et Mahdad accompagner mes pauvres rabbins dans les oubliettes religieuses et sémitiques, auxquelles la République généreuse m’arrachait pour me permettre de m’épanouir au grand soleil des idéaux révolutionnaires. Je me mis à lire Marx, à ne plus penser à l’univers de la Bible, à oublier les Psaumes et Isaïe, à délaisser toute pratique religieuse, si ce n’était m’abstenir de manger du pain à Pâque et jeûner pieusement le jour du Kippour. J’avais insensiblement changé de peuple élu, passant de mon Orient originel à cet Occident dont la France me paraissait être la lumière et l’espérance.
À cette alchimie culturelle qui commençait à opérer en moi vint s’adjoindre l’élément physique fondamental et constitutif de ma personnalité : le handicap. J’eus une enfance maladive dont l’attachement à la vie puisa ses forces dans l’amour de mon entourage. À plusieurs reprises, la mort voulut m’emporter, mais l’Elohîms qui nous garde ne le lui permit pas. Que d’angoisses les poitrines de ma mère et de mes sœurs n’épanchèrent-elles pas ! De tous leurs êtres, de toutes leurs âmes, elles venaient à ma rescousse tandis que je luttais contre la mort ou que je menaçais de sombrer dans l’infinie solitude de la dépression. Enfant, je découvris que l’amour ‘des femmes est salvateur. Il n’est rien d’impossible, il n’est pas de situation inextricable pour un homme, dès lors qu’il est aimé des femmes de sa vie. De l’enfant à l’homme que je suis devenu, chaque jour m’en a fait le rappel : je dois tout ce que je suis aux femmes qui ont accompagné ma vie.
Je trahirais leur souvenir si je ne leur rendais pas l’hommage de gratitude que je leur dois. Et d’abord à ma mère, Meleha Lilas, fille aînée des onze enfants d’Abraham Meyer, mon grand-père. Elle eut elle-même dix enfants, dont mes trois sœurs Marie, Lucie et Alice : à l’ère post-pilulaire où nous vivons, ces familles nombreuses peuvent paraître exotiques : ce sont elles cependant qui constituaient la chair et le sang de l’humanité entière. En ce qui me concerne, ma mère et mes trois sœurs m’ont donné et à maintes reprises rendu la vie par l’ amour dont elles me nourrissaient. D’être né dans une famille si nombreuse et d’avoir grandi dans les bras de mes quatre femmes escortées par d’innombrables tantes et cousines m’a permis de survivre à mon enfance maladive et cependant comblée du bonheur de vivre, d’être aimé et d’aimer.
À peine lâché dans les méandres de l’école publique et obligatoire, j’étais suspendu aux lèvres de mes institutrices et de mes infirmières. Les lettres d’Yvonne Jean [1] ainsi que ma correspondance avec Colette Boyer [2] témoignent de l’intensité d’échanges sans lesquels nos vies n’auraient pu devenir ce qu’elles furent. Colette m’a épousé avec la conscience de me suivre sur une voie qui risquait de nous conduire directement au four crématoire d’un camp nazi : et cette fin ne nous fut épargnée que de justesse.
La douleur qui devait imprégner ma chair tout le long de ma vie commença un jeudi du mois de juin 1924. Rentrant chez moi après les classes du matin, un vent sablonneux électrisait l’atmosphère, je fus assailli par une volée d’enfants qui m’assenèrent des coups de cartables sur la tête, au cri de : Judios mala razza, « sale race de juif ». Seule la fuite se présentait à moi. J’arrivais chez moi au terme d’une course effrénée, grelottant de peur et de fièvre.
La frayeur et la forte grippe que diagnostiqua le docteur appelé à mon chevet dégénéra rapidement — en dépit des aspirines qu’il prescrivit — en paralysie. Il fallut l’intervention d’un second médecin pour que l’on découvrît la vérité : je souffrais d’une attaque de poliomyélite aiguë. Cette maladie sévissait à l’époque, particulièrement en Afrique où elle faisait des ravages souvent mortels. La médecine était désarmée face à ce virus dont le vaccin n’existait pas alors. Je survécus néanmoins à cette maladie.
Un handicap, de quelque sorte qu’il soit, s’il ne nous tue pas nous fortifie. Il nous enseigne le courage, nécessaire vertu pour affronter les aléas de la vie. Avec le recul, le courage qui m’a permis de dépasser mon handicap m’a aussi permis de ne pas succomber aux différents drames auxquels j’ai pu être confronté tout au long de mon existence. Ce coup du sort fut pour moi une école de persévérance et d’espérance : je compris qu’il faut sans cesse s’obstiner à choisir la vie face à tout ce qui pourrait nous en détourner.
J’étais doté d’une jambe gauche complètement paralysée. Au terme de ma croissance, elle mesurait quatre centimètres de moins que ma jambe droite. À droite, je devins un homme qui mesurait un mètre soixante-cinq. A gauche, je n’avais plus qu’un mètre soixante et un.
Plutôt que de me projeter dans le réel, je laissais celui-ci se refléter en moi. Il me semblait que j’étais le miroir silencieux de tout ce qui se passait autour de moi. Cette vertu d’essence contemplative me permettait de tout entendre, de tout voir, sans être tenté de me projeter dans l’objet de ma contemplation. Un miroir n’est jamais encombré par les objets qu’il reflète. J’étais le de la lumière, des formes, des personnes, des faits et des mots que je voyais ou que j’entendais dans un paysage dont j’étais absent. D’où une insatiable curiosité, une infatigable ardeur à voir, à entendre, à connaître davantage ce qui existai autour de moi, puisque je n’étais moi-même que le miroir du réel.
[1] . Lettres à André Chouraqui, Yvonne Jean.
[2] . Ton étoile et ta croix, André Chouraqui.